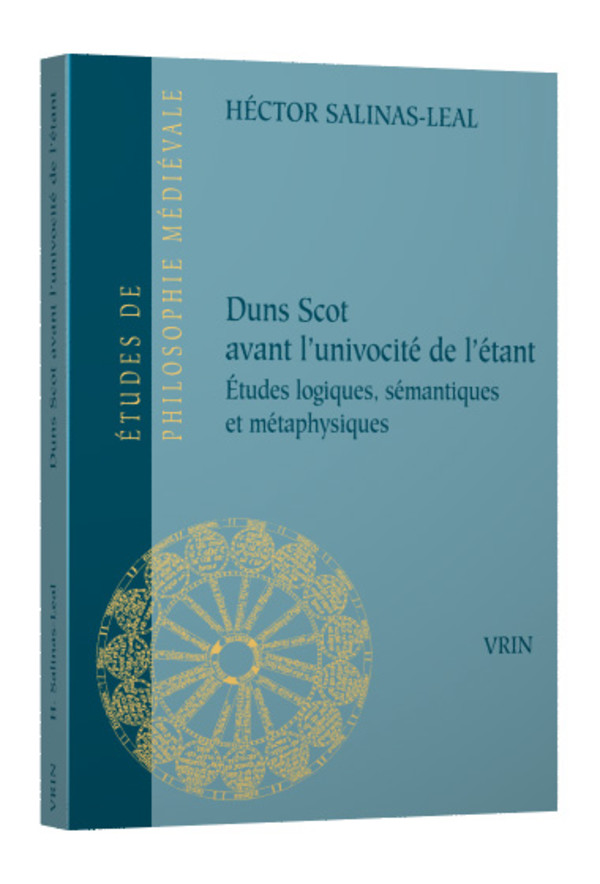Salomon le-beit ha-Lévi - Entretien avec Jean-Pierre Rothschild
01 février 2025
Autour de la traduction du Traité de la liberté, de Salomon le-beit ha-Lévi
Salomon le-beit ha-Lévi, Traité de la liberté, Texte hébreu traduit, introduit et annoté par J.-P. Rothschild, Vrin, collection de poche bilingue « Translatio », janvier 2025, 15€
Vrin - Ce volume propose une traduction de l’hébreu du Traité de la liberté, nous plongeant ainsi au cœur de la pensée séfarade. Au vu de la richesse de la philosophie juive espagnole, et du nombre d’œuvres qui ne sont pas (encore) accessibles au lecteur non-hébraïsant, quelle(s) raisons(s) vous ont conduit à choisir ce texte en particulier ?
Jean-Pierre Rothschild - Il y a comme toujours des raisons de fond et des raisons de circonstance. Quant aux circonstances, ma carrière à l’Institut de recherche et d’histoire des textes du CNRS a fait de moi un découvreur de textes ignorés ou mal connus ; philologue plus que philosophe de formation, je me crois plus de légitimité à exhumer un texte oublié, à le rendre intelligible dans les termes historiques, littéraires et doctrinaux de son temps et à en dégager l’intérêt, qu’à avancer après cent autres une nouvelle interprétation d’un grand classique. Quant au fond, Salomon le-beit ha-Lévi arrive en position de récapituler une importante tradition intellectuelle et littéraire près de s’éteindre : celle de la tradition juive en présence de la philosophie morale aristotélicienne. L’étude de son ouvrage est donc l’occasion de traverser toutes les strates successives de cette tradition, de la passer en revue tout entière de manière rétrospective, en même temps que de chercher à saisir les raisons, ou du moins certaines des raisons, de sa prochaine extinction. Et puis, s’intéresser aux ouvrages négligés (pas n’importe lesquels, cependant !) est aussi l’occasion de porter un regard modifié sur toute une famille de pensée qu’on croyait bien connaître, et cette modification se répercute aussi dans la lecture des « grands » textes.
Vrin - L’introduction et la présentation du contexte historique s’avèrent essentielles pour la compréhension du traité. À la page 57, vous évoquez une « consonance inattendue » entre les auteurs latins classiques et la pensée juive de l’époque. D'où vient-elle ? Quelle est la spécificité de cette « consonance » et en quel sens est-elle « inattendue » ?
Jean-Pierre Rothschild - Il nous paraît inattendu – incongru – qu’un auteur juif ottoman du XVIe siècle se réfère à Sénèque ou à Cicéron parce qu’une historiographie développée à partir du XIXe siècle, qui a la vie dure, nous a appris à opposer à l’« âge d’or » d’une convivencia islamo-juive, en Espagne, durant le haut Moyen Âge, une situation d’hostilité culturelle supposée constante entre christianisme et islam au Moyen Âge tardif et au-delà. Il y a tout de même une soixantaine d’années (je pense à un article mémorable de Giuseppe Sermoneta sur le philosophe-théologien juif et traducteur du latin Juda Romano, en Italie) que le vent a commencé à tourner et, depuis quelques années, il est devenu une forte brise : tant en histoire littéraire qu’en histoire sociale, on a découvert l’intensité des échanges de toutes sortes entre chrétiens et juifs au Moyen Âge tardif, en dépit des restrictions légales, des persécutions sporadiques ou systématiques, des tentatives de conversion dont la minorité faisait l’objet. Ce que toute une ancienne école d’études juives n’admettait qu’avec réticence, l’existence d’emprunts juifs à la littérature latine, a été révélé dans toute son importance. Mais il y a encore loin des études novatrices à l’opinion générale. Il reste donc « inattendu » qu’un juif fidèle ait lu Sénèque, et plus encore à l’autre extrémité du bassin Méditerranéen, en pays musulman.
Mais l’histoire littéraire doit beaucoup aux malentendus. L’un des types les plus répandus en est de croire trouver une convergence quand on observe des similitudes entre deux traditions, dont l’une a connu jadis l’influence de l’autre, entre-temps oubliée ou occultée : c’est le cas d’un assez grand nombre de sentences rabbiniques dont le fond ou la forme se ressentent du stoïcisme et peuvent avoir des parallèles chez Cicéron et Sénèque. À l’époque qui précède celle de Salomon le-beit ha-Lévi, trois phénomènes ont pu précipiter ce rapprochement des semblables : l’humanisme espagnol du XVe siècle, auquel les juifs participèrent (point méconnu, que mettent pourtant en valeur les travaux de l’historien israélien Éléazar Gutwirh) ; procédant de l’humanisme, la traduction des classiques latins les plus populaires en langue vernaculaire espagnole facilita leur appropriation par un lectorat juif qui lisait rarement le latin ; l’expulsion des juifs de la péninsule Ibérique (1492, 1497 pour le Portugal) donna lieu à la reconstitution de communautés, dans l’Empire ottoman en particulier, soucieuses de ressaisir les signes de leur appartenance à la glorieuse culture antérieure, parmi lesquels les références aux auteurs latins, et particulièrement à Sénèque, né dans la Péninsule et figure d’écrivain national de l’Espagne.
Vrin - Dès le préambule, vous revenez sur la proximité avec le De vita beata de Sénèque, et vous soulignez que le titre même de Traité de la liberté n’est pas du fait de l’auteur mais un choix de traduction, pourriez-vous nous expliquer plus en détail le choix de ce terme ?
Jean-Pierre Rothschild - Le titre donné par l’auteur, « Porte de l’espoir », n’est pas explicite. Il fallait donc trouver un titre français qui caractérisait d’emblée l’ouvrage. Traité de la liberté s’est imposé à moi pour deux raisons : l’usage, unique à ma connaissance dans la littérature juive médiévale ou post-médiévale, des sources latines faisant référence à la liberté stoïcienne (Sénèque ; dans une moindre mesure, Cicéron) ; et le fait que ce thème de la liberté se retrouve dès l’Antiquité tardive dans la tradition juive, sous l’énoncé qui veut qu’il n’y ait pas de plus grande forme de la liberté (voire, pas d’autre liberté véritable) que d’obéir délibérément à la Loi divine. De plus, c’est précisément cette remarquable convergence thématique qui justifie l’emploi efficace que Salomon le-beit ha-Lévi a pu faire de ces sources latines.
Vrin - Le Traité de la liberté doit évidemment beaucoup à Maïmonide et aux « classiques » de la philosophie juive espagnole de l’époque, mais au sein de cette œuvre, l’auteur confère une place de choix aux grands auteurs de la tradition gréco-latine. Selon vous, en quoi consiste donc son originalité ?
Jean-Pierre Rothschild - Il ne s’agit évidemment pas de penser l’originalité en termes romantiques de rupture ou de nouveauté absolue. Bien au-delà du Moyen Âge, on écrit avec le projet délibéré de s’inscrire dans une tradition. Salomon le-beit ha-Lévi n’est pas le premier à confronter les fins de l’homme selon l’Éthique à Nicomaque et selon la tradition juive ; rendue possible par la traduction d’arabe en hébreu du Commentaire moyen d’Averroès sur l’Éthique, en Provence, au XIVe siècle, puis par la traduction du texte même de l’Éthique à partir du latin, en Espagne, vers 1400, cette confrontation avait en particulier été le fait de Joseph ben Shem Tov au milieu du XVe siècle, dans un traité intitulé Kevod Elohim (La gloire de Dieu) puis dans un vaste commentaire de l’Éthique. Salomon le-beit ha-Lévi peut être considéré comme original par trois points : il est le premier à intégrer les sources latines à la confrontation ; il témoigne, plus d’un demi-siècle après l’expulsion des juifs d’Espagne, d’une persévérance dans la transmission et la mise en œuvre de la culture ibérique du siècle précédent qui n’est plus le fruit naturellement éclos d’un milieu favorable mais relève de la volonté et de l’effort ; il est enfin le dernier représentant connu de cette tradition dont il récapitule les strates multiples ; c’est peut-être à son corps défendant ; ou bien, il aura lui-même jugé, en avançant en âge, que penser dans ces termes-là dans la société ottomane de la fin du XVIe siècle n’était plus pertinent ; nous n’en savons rien.
Vrin - Comme vous le rappelez dans l'introduction, le traité est comme « à la croisée des langues », entre l'hébreu, le judéo-espagnol, ainsi que le latin. Quels principes ont guidé votre traduction de ce texte, et quels sont les écueils à éviter ?
Jean-Pierre Rothschild - En un sens – c’est une banalité –, toute traduction est vouée à l’échec : ce qui se gagne du côté de la fidélité à la langue de départ et à toutes ses nuances se perd du côté de l’intelligibilité et de l’esthétique dans la langue d’arrivée, et inversement. Il n’est sur ce point que de renvoyer, au plus près du texte qui nous occupe, à la fameuse dispute entre le converso, prélat et humaniste espagnol Alphonse de Carthagène et l’humaniste italien Leonardo Bruni, précisément à propos de la traduction de l’Éthique à Nicomaque. Dans le cas particulier de mon travail, je devais prendre garde à deux choses : le style personnel de Salomon le-beit ha-Lévi ne craint pas des redondances qu’il convenait d’alléger pour ne pas rendre rebutante la lecture en français ; à certains moments, et sans avertissement (car la précision des références à ses sources n’est pas son fort), il citait presque littéralement la traduction de l’Éthique réalisée par Meir Alguadez à l’extrême fin du XIVe siècle : il convenait alors de tenir compte dans ma propre traduction du lexique de celui-ci et de ses équivalences dans la tradition française de traduction de l’Éthique, selon la traduction du grec par Jules Tricot, celle que j’ai utilisée, mais aussi compte tenu, au besoin, de l’intermédiaire du latin de Robert Grosseteste dont s’était servi Alguadez mais que Tricot n’avait pas eu de raison de prendre en compte systématiquement.
Heureusement pour lui, le traducteur, dans sa tâche impossible, peut s’expliquer sur certains points généraux dans son introduction et sur d’autres, particuliers, dans ses notes, allégeant ou simplifiant d’autant sa traduction. Il n’en reste pas moins que, souvent tenté par la littéralité, je n’ai pas craint de recourir aux parenthèses carrées pour signaler le comblement de maintes ellipses de l’original, imitant en cela, sans l’avoir voulu – et sans songer un instant à me comparer à lui –, le très savant traducteur anglais du Guide des égarés en 1963, Salomon Pinès ; mais, contrairement à lui, je n’ai pas trouvé chez Vrin de responsable éditorial pour me brider à cet égard – ou pour me sauver de mes démons personnels.
Propos recueillis par Pauline Brousse