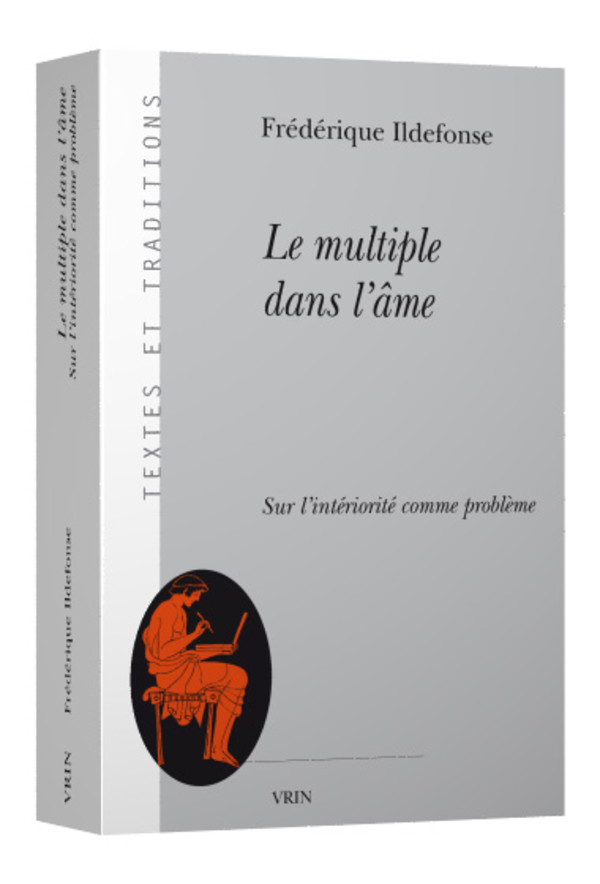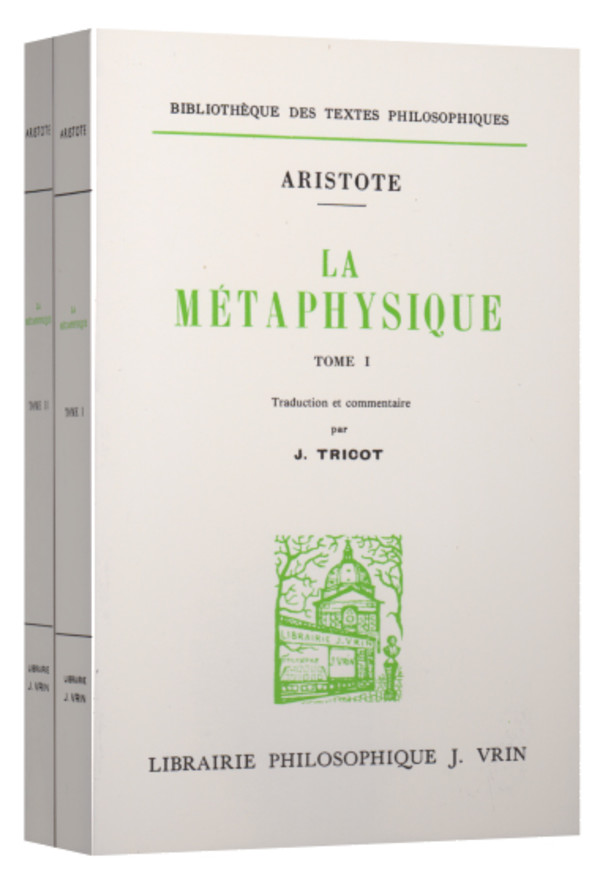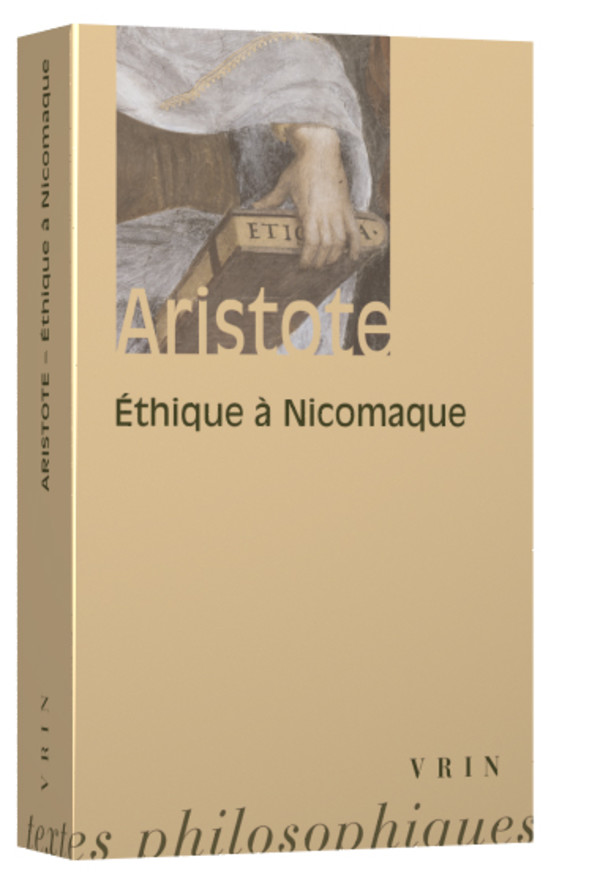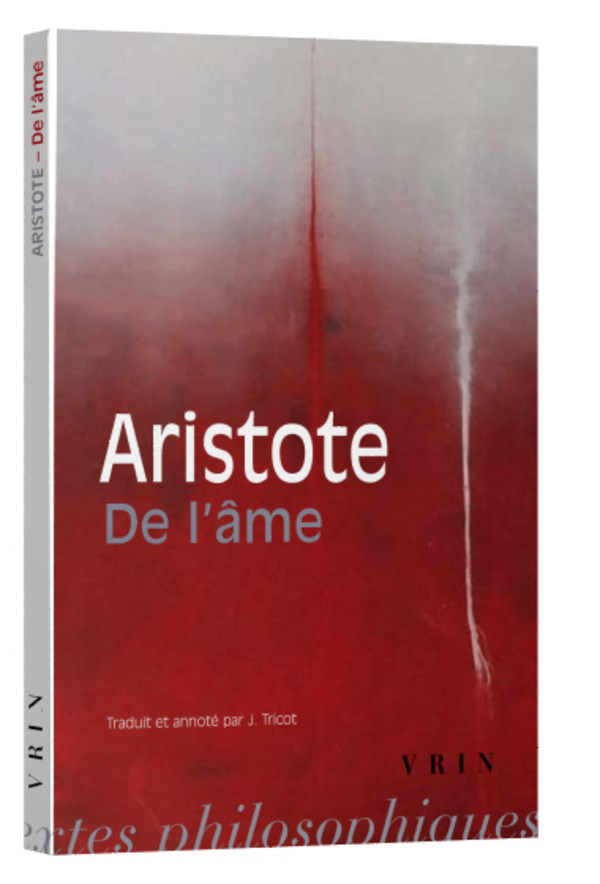Entretien avec Frédérique Ildefonse
03 février 2023
À propos du livre Le multiple dans l'âme. Sur l'intériorité comme problème (Vrin, 2022, collection « Textes et traditions »)
Vous parlez, dès l’introduction, de différents écueils que l’on risque de rencontrer en s’attaquant à la question de l’intériorité chez les Grecs (pronominalisation, inadéquation de nos catégories langagières et de pensée par rapport aux textes anciens, etc). En quoi consistent-ils exactement ?
Le projet de ce travail est venu de la lecture d’une phrase de Jean-Pierre Vernant dans « La fabrique de soi » – « Il y a toute une histoire de l’unité et de l’intériorité du moi qui est à faire » –, projet que j’ai choisi, dans un premier temps, d’abréger en projet d’une histoire de l’intériorité. De l’intériorité, j’ai ensuite choisi de rétrograder, pour ainsi dire, à l’intérieur, dès lors que l’intériorité, telle que nous la présupposons le plus souvent, est déjà une certaine interprétation de l’intérieur mental, ou psychique. J’ai été d’emblée gênée par la projection des concepts modernes, chacun d’ailleurs de provenance différente, sur les textes anciens : moi, soi, sujet, personne, individu. Que nous ayons à présent tous ces concepts à disposition n’implique pas qu’ils vaillent pour les textes anciens, et de fait la traduction des textes où ils apparaissaient s’avérait souvent « gonflée » ou infléchie : « à l’intérieur » était souvent traduit par « en moi », « en nous-mêmes », pour ne donner que ce seul exemple. De même, il ne me paraissait pas, pour comprendre les textes anciens, devoir en passer par la pronominalisation : pourquoi la conceptualisation devrait-elle se réduire à la pronominalisation : moi, je, soi, etc. ? Les textes anciens parlaient d’intellect, et pour essayer de comprendre ce qu’ils entendaient par-là, il n’était pas nécessaire de réduire l’intellect à un concept issu d’un pronom. Pourquoi la scène de l’interlocution qui est celle qui amène à une distribution des personnes grammaticales devrait-elle être absolument décisive en tout ?
Par exemple, sur le thème de la conscience, vous écrivez que la sensation de soi, la perception de soi (que l’on peut trouver chez des auteurs grecs) ne correspondent pas à ce que nous nous appelons conscience (IIIe Partie, chapitre 3). Que faut-il alors entendre par cette sensation de soi si ce n’est pas une conscience de soi ?
Tout d’abord, ce que nous appelons communément conscience se dit en grec en termes de sensation : le verbe grec est αἰσθάνομαι, auquel s’oppose le verbe λανθάνω. On distingue donc littéralement entre ce que nous sentons et ce qui nous échappe. Par exemple, au livre IX de l’Éthique à Nicomaque, Aristote parle de ce qui sent que je sens et qui sent que je pense. Romeyer-Dherbey et Vernant avaient déjà indiqué, à partir d’un passage du livre Λ de la Métaphysique, qu’à la différence de l’acte pur du dieu, qui se pense lui-même, la sensation et la connaissance humaines sont « toujours d’un autre » et « de soi-même par surcroît » : l’âme « se saisit donc elle-même en plus, par-dessus le marché si l’on peut dire ». Ce qui prime, c’est la sensation que nous avons de nos actions et de nos passions, la sensation que nous avons de nous-mêmes est seconde par rapport à celle-ci : c’est une co-sensation de nous-mêmes qui s’ajoute à nos affections. Un des termes que nous pouvons, dans certaines de ses occurrences (ce n’est pas le cas, par exemple, lorsqu’Aristote l’emploie pour qualifier le lien à l’ami), traduire par « conscience », dans certains textes anciens, est συναίσθησις : le terme même, composé du substantif αἴσθησις (sensation) et de la préposition σύν, qui signifie avec, suppose un rassemblement dont la considération reste plus présente que dans la plupart de nos usages du mot « conscience », pourtant composé lui aussi à partir de la proposition cum, avec en latin. Restent la question de ce qu’on appelle le plus souvent perception de soi-même chez Hiéroclès, qu’il présente comme première, et dont on peut se demander si elle est ou non une position stoïcienne orthodoxe, ainsi que la très vaste question de l’οἰκείωσις, qu’on peut traduire par appropriation, sentiment par lequel un vivant vise naturellement à conserver sa propre constitution et ses rejetons.
Schématiquement, la question du ‘soi’ peut poser trois types de questions : (i) celle de l’identité de l’individu, (ii) celle de l’unité de l’individu et (iii) celle de l'essence de l’individu. Comment se croisent ces trois fils dans les textes antiques et quelle redéfinition – ou au moins reformulation – de la notion d’individu cela implique-t-il ?
Tout d’abord il faut bien préciser que l’identité de l’individu n’est pas une identité personnelle. Elle ne se confond pas avec l’ensemble des événements, des souvenirs, des actions et des passions qui constitue pour nous le plus souvent la vie d’un vivant humain. D’autre part, et c’est l’idée centrale qui a donné le titre de mon livre, Le multiple dans l’âme, il faut bien comprendre que sous l’unité qu’assure la circonscription visuelle d’un individu humain, d’une âme inscrite dans un corps (le temps de telle ou telle vie), il importe de déceler une complexité psychique et d’en rendre compte. Un passage du livre IX de la République donne la représentation d’une telle complexité de l’âme. Où faut-il alors situer l’unité ? Que faut-il entendre par là ? Qu’est-ce qui vient l’assurer ? Est-elle en toute situation assurée ? L’unité psychique de tel ou tel vivant humain ne va pas de soi quand bien même son âme est présentée comme la somme de parties disparates qui sont rendues solidaires entre elles plus qu’unifiées et s’il est préférable de l’assurer elle ne l’est pas en tout cas. Elle est assurée lorsque le vivant humain agit sous l’empire de la part rationnelle de son âme. Derechef, l’identité n’est pas personnelle. Vernant là encore a souligné le caractère impersonnel de l’âme. Mais qui dit âme impersonnelle n’exclut pas que l’âme soit singulière. Cette singularité s’entend par rapport à une distribution des âmes qui est une distribution des essences.
Il y a un thème qui revient souvent, celui des figures de « l’autre à l’intérieur », figures qui sont multiples (l’enfant qui a peur de la mort, le fragment du dieu…) : que faut-il entendre par cet autre à l’intérieur ?
Il est difficile, en raison des multiples figures que vous évoquez, d’élucider ce qu’il faut entendre par cet autre à l’intérieur en général, par-delà ces multiples figures. Ce qui est certain, c’est que l’expérience que nous faisons de notre intérieur psychique ou mental a à voir avec ce que j’appelle l’hospitalité psychique – nous hébergeons à l’intérieur de nous une instance extérieure, qu’il s’agisse ou non de l’intellect, cet intellect dont Aristote dit littéralement qu’il entre en nous par la porte. Plutarque, dans Le démon de Socrate, nous livre un texte limpide à cet égard. Il précise qu’à la différence de l’âme qui est la part immergée dans le corps, qui l’entraîne, la plupart appellent intellect la part inaccessible à la corruption et croient qu’il est à l’intérieur d’eux, comme on croit que sont dans les miroirs les objets qui s’y reflètent. Mais, ajoute-t-il, les gens qui pensent correctement comprennent qu’il est extérieur et l’appellent δαίμων, démon. Ce qui est en jeu, c’est aussi la manière dont l’expérience rituelle de la possession qui est possession par le dieu (Platon parle d’enthousiasme) se trouve développée, métabolisée dans les différents textes anciens – sans qu’il s’agisse de réduire la gnoséologie ou la psychologie à cette expérience rituelle. Toutefois, ce qui est certain, c’est qu’à l’intérieur ce n’est pas moi que je trouve, ni seulement le maillage de mes sensations, de mes pensées avec mes souvenirs. Et qu’il s’agisse de l’intellect ou du δαίμων, se trouve chevillé à cette instance extérieure que nous hébergeons, avec laquelle nous habitons, quelque chose de notre identité, et d’une identité qui n’est certes pas immédiate, mais qui oriente, normativement, nos actions et nos pensées.
Pour revenir à notre question initiale, sur les écueils à éviter, quelle doit alors être la méthode du traducteur ou de l’historien de la philosophie ?
Il me semble qu’il est avant tout nécessaire de ne pas projeter des concepts extérieurs sur les textes anciens. Quand on y regarde de près, il me semble que cette projection se fait toujours lorsque ce qui domine n’est pas l’objectif de connaître ce qui est en jeu dans les textes, mais de reconnaître quelque chose que nous connaissons déjà. À cet égard, la projection des concepts modernes sur les textes anciens est toujours en fait, me semble-t-il, l’effet d’une lecture impatiente qui croit reconnaître et abrège : « – En fait, c’est cela. ». En se donnant le faux plaisir de la reconnaissance, elle interrompt la lecture qui doit s’opérer jusque dans le moindre détail. Et bien certainement, lire, pour comprendre, suppose de ne pas sélectionner de manière péremptoire ce qu’on juge capital au détriment de ce qu’on pense secondaire. C’est le point commun entre lecture et ethnographie, et il importe de ne jamais céder sur l’étrangeté et la complexité des textes abordés.
Propos recueillis par Irene Soudant